Par Guillaume Durieux, Jean-Yves Pranchère et Jean-Louis Vullierme
Avant d’être publié sur le site Cosmocène et repris sur le site de l’INRER, l’important article de Jean-Louis Vullierme sur le pagliacisme avait fait l’objet de discussions sur les pages Facebook où il avait été initialement publié en juin 2018. Il nous a semblé intéressant de poursuivre ici ces discussions.
Quiconque a lu le livre décisif que Jean-Louis Vullierme a écrit sur le nazisme (Le nazisme dans la civilisation. Miroir de l’Occident, 2e édition revue, L’Artilleur, 2018) sait que les analyses du profond penseur politique qu’il est ont la vertu de fournir à la fois des instruments théoriques opératoires, des mises en perspective historiques extrêmement informées et des suggestions stimulantes qui s’offrent à des débats fructueux. Même les contestations qu’on peut lui opposer doivent lui être reconnaissantes des clartés nouvelles qu’il leur apporte. Comment délimiter la notion de « pagliacisme » ?
On trouvera ci-dessous les objections de Guillaume Durieux, professeur de philosophie, qui prépare une thèse sur « La possibilité du politique. Étude du schème d’intelligibilité statocentrique : Hegel, Marx, Weber, Schmitt », les remarques de Jean-Yves Pranchère et les réponses de Jean-Louis Vullierme.
1. Guillaume Durieux : N’y a-t-il que des idiots pour suivre un clown ?
2. Jean-Yves Pranchère : Le pagliacisme n’est pas un populisme. Propositions pour consolider l’originalité du concept de pagliacisme.
3. Jean-Louis Vullierme : L’intelligence du pagliacisme.
Guillaume Durieux : N’y a-t-il que des idiots pour suivre un clown ?
Je voudrais, dans les quelques lignes qui suivent, proposer une réponse au texte de Jean-Louis Vullierme. Dans son texte, Vullierme propose un élargissement de « la nomenclature politologique au “pagliacisme” (de pagliaccio, italien pour clown), défini comme forme d’idiocratie consistant à porter systématiquement au pouvoir les personnes les plus incompétentes, sous l’égide d’un matamore (personnage de la commedia dell’arte, se vantant d’exploits impossibles) ». Or, les raisons qu’il avance me paraissent contestables.
Le pagliacisme selon Vullierme
La thèse, en substance, consiste à soutenir que l’émergence et le succès de leaders politiques exhibant volontairement et éhontément des attitudes grotesques qui, en d’autres circonstances, auraient dû les disqualifier, ne sont pas anecdotiques mais constituent au contraire un phénomène politique sui generis qui mérite d’être analysé comme tel – et cela d’autant plus que le pagliacisme est présenté comme « la plus grande menace contre les démocraties parlementaires depuis l’émergence des doctrines de Parti unique ». Ce qui justifie de faire du pagliacisme une catégorie à part, c’est qu’on ne saurait en faire une simple espèce du genre « populisme ». Au contraire, selon Vullierme, l’ordre est inverse : le populisme est une conséquence et non une cause du pagliacisme. Si le leader pagliaciste parvient à retourner le stigmate lié aux attitudes grotesques, c’est parce que l’exhibition impudique et revendiquée de ces attitudes fonctionne comme un signal d’indépendance par rapport au jugement d’autrui et donc, ce faisant, comme signe d’une « souveraineté renforcée ».
On ne saurait nier qu’une telle description est suggestive et constitue un prisme stimulant au travers duquel observer les stratégies adoptées par les différents acteurs du jeu politique. Cependant, il me semble que trois problèmes liés grèvent cette analyse et en compromettent la fécondité.
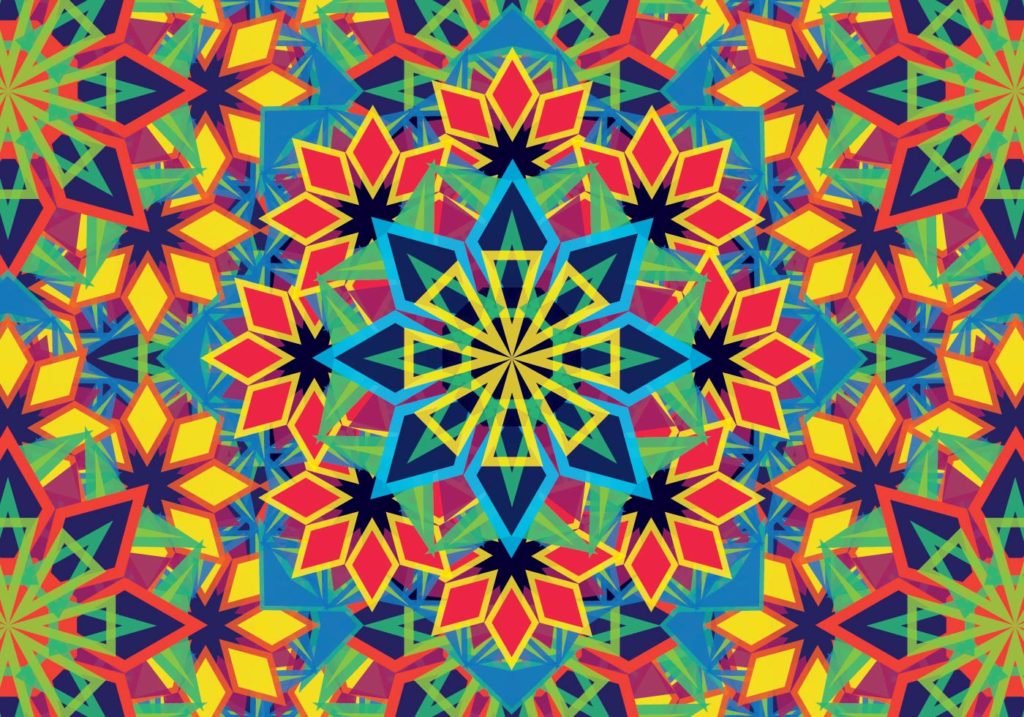
Quid de l’électorat ?
En premier lieu, Vullierme insiste pour lier conceptuellement pagliacisme et idiocratie. Les succès médiatiques et électoraux du matamore ne peuvent s’expliquer que par le manque d’éducation des électeurs qui seraient incapables de discerner l’absurdité des revendications et des prétentions du pagliaciste. Ces électeurs se voient ainsi réduits à n’avoir d’autre rôle que de réagir de manière purement émotionnelle à un spectacle médiatique dont ils acceptent passivement le message avec les stéréotypes qu’il porte.
On est frappé par l’élitisme d’une telle analyse. Le texte n’entreprend pas à un seul moment de s’interroger sur l’existence d’éventuelles bonnes raisons justifiant les choix électoraux de ceux qui soutiennent des leaders pagliacistes. En effet, le programme et les revendications de ces leaders sont censés contredire « objectivement le plus grand nombre [des] intérêts » de ceux qui les soutiennent pourtant. Le pagliacisme fait fond sur la bêtise ou l’ignorance de l’électorat. On aurait néanmoins aimé connaître quels étaient ces intérêts objectifs et quelles mesures concrètes les pagliacistes proposent qui les contredisent si manifestement. À défaut, l’affirmation paraît gratuite : sur quelle sociologie électorale s’appuie-t-elle ? Comment établir les intérêts objectifs des électeurs ? Et faut-il comprendre que ces électeurs sont incapables d’identifier leurs propres intérêts ou que, les identifiant correctement, ils sont subjugués par les rodomontades du matamore ? Il est pourtant loin d’être évident, pour ne prendre qu’un exemple, que le durcissement des conditions d’accès au marché états-unien pour les produits chinois soit à ce point en contradiction avec les intérêts bien compris de la base électorale de Donald Trump. En somme, il est très discutable d’entreprendre d’expliquer un phénomène quelconque par la bêtise ou l’ignorance supposées des individus. On ne voit pas ce qui autorise à décider a priori que les électeurs soutenant Trump ou Salvini sont idiots ou irrationnels. C’est peut-être même se laisser prendre tout à fait dans le piège qu’ils tendent en adoptant ce genre de stratégie de communication : faire en sorte que les élites qu’ils dénoncent les rejettent, eux et leurs électeurs, à cause de leur bêtise prétendue, c’est-à-dire uniquement à cause de la sorte de personne qu’ils sont et non à cause de leurs idées ou de leurs programmes. À dénoncer inlassablement le grotesque du pagliaciste, on corrobore l’une de ses affirmations sans cesse répétée : on n’a rien de sérieux à lui répondre sur le fond. La stratégie de diabolisation – ou de pagliacisation donc – est peut-être tout aussi efficace, électoralement parlant, que celle de dédiabolisation.
La question de l’irrationalité
On rejoint ici le second problème que pose cette analyse. Il n’est possible de constituer le pagliacisme comme catégorie à part entière de la nomenclature politologique qu’à la condition de faire de la bêtise des électeurs la cause du succès des leaders pagliacistes – sans quoi ces électeurs discerneraient sans mal, on suppose, l’absurdité des revendications et des prétentions accompagnant les attitudes grotesques du matamore. Mais, si l’on refuse de faire de la bêtise l’explicans du succès des leaders pagliacistes, il n’est pas certain que l’on puisse maintenir la prétention à faire du pagliacisme une catégorie autonome.
J’accorderais sans mal que l’adoption d’attitudes grotesques fonctionne comme signal de souveraineté renforcée et d’indépendance vis-à-vis du jugement porté. Seulement, il est loin d’être clair que la sensibilité à un tel signal ne puisse s’expliquer que par la bêtise, l’irrationalité ou l’émotion.
Admettons même, pour l’hypothèse, que l’on puisse affirmer de manière certaine que les revendications des leaders pagliacistes sont objectivement en contradiction avec les intérêts de leur électorat. Lorsque les intérêts fondamentaux de certains individus sont durablement négligés par les politiques publiques et les partis traditionnels, il peut être rationnel, pour ces individus, d’être irrationnels. C’est-à-dire qu’il peut être rationnel pour eux de voter pour des leaders qui ne tiendraient pas plus compte de leurs intérêts, voire agiraient directement à l’encontre de ces intérêts. En effet, si ces leaders occupent une position « antisystème » dans le champ politique, ils contraindraient, du fait de leurs succès électoraux, les partis traditionnels à tenir compte des intérêts de ces électeurs qu’ils négligeaient auparavant dans l’espoir de reconstituer une base électorale solide. Peut-être le pari est-il risqué mais on ne saurait dire qu’il est purement irrationnel. Cependant, si l’adoption d’attitudes grotesques n’est qu’un signal parmi d’autres indiquant l’extériorité au « système » que revendique le leader pagliaciste, on retombe en fait dans le cadre d’une approche classique en terme de populisme. Contrairement à ce qu’affirme Vullierme, c’est le grotesque qui dérive du populisme et non l’inverse. Que le concept de populisme soit d’un usage discuté et discutable, c’est certain. Mais on ne voit pas comment celui de pagliacisme pourrait constituer une alternative pertinente à celui-ci ou même une catégorie politologique théoriquement robuste.
La dimension idéologique
Enfin, le troisième problème que pose cette analyse, c’est qu’elle implique paradoxalement de neutraliser la dimension idéologique des revendications et prétentions des leaders pagliacistes. Puisque c’est la bêtise ou l’ignorance des électeurs qui est en cause et non pas le fait que ces électeurs peuvent en venir à soutenir activement des programmes politiques qui nous paraissent idéologiquement déplorables, on vide le débat politique de toute signification : à quoi bon débattre démocratiquement du bien-fondé de tel ou tel programme si, de toute manière, les électeurs sont trop bêtes ou ignorants pour être sensibles aux raisons échangées ? L’idéal démocratique est mis en échec lorsqu’on en vient à soutenir qu’une partie des individus est trop bête ou trop ignorante pour être accessible aux raisons publiquement échangées. La démocratie est défaite non quand des forces la contestent de l’intérieur, mais quand ceux qui la défendent en viennent à soutenir que le peuple n’est pas à la hauteur de celle-ci.
Comprendre des menaces spécifiques
Concluons. Le concept de pagliacisme, tel que Jean-Louis Vullierme en propose l’esquisse, semble inséparable de la thèse selon laquelle les succès politiques du matamore ne peuvent reposer que sur la bêtise ou l’ignorance des électeurs. Cette thèse cependant est à la fois moralement problématique, empiriquement arbitraire, méthodologiquement stérile et politiquement inquiétante. Ces problèmes importants me conduisent à penser que le concept de pagliacisme ne saurait constituer une catégorie politologique pertinente et opératoire. Rejeter la pertinence d’un concept n’est pas pour autant nier les faits que ce concept avait vocation à saisir. L’idéal démocratique est aujourd’hui, à n’en pas douter, soumis à des menaces spécifiques qu’il convient de comprendre pour mieux les affronter. Bien que, s’agissant du concept de pagliacisme, il s’agisse, je crois, d’une impasse, on ne saurait donc nier l’importance de ce genre de tentative d’actualiser notre appréhension politique du présent.
Jean-Yves Pranchère : Le pagliacisme n’est pas un populisme
Propositions pour consolider l’originalité du concept de pagliacisme
La proposition faite par Jean-Louis Vullierme de réunir sous le terme de « pagliacisme » un certain nombre de phénomènes contemporains me semble à la fois judicieuse et féconde. Mais je n’ignore pas le poids des objections faites ici par Guillaume Durieux. Je voudrais donc défendre l’usage de ce terme en proposant d’en nuancer la justification sur deux points : d’une part, en suggérant de la dissocier de la notion, trop incertaine, d’« idiocratie » ; d’autre part, en insistant davantage sur sa différence avec le concept, équivoque et trompeur, de « populisme ».
Il me semble en effet que le terme de « pagliacisme » est un terme beaucoup plus juste que celui de « populisme » pour décrire des phénomènes politiques contemporains auquel le terme de populisme est appliqué à tort.

Qu’est-ce que l’idiocratie ?
Ma première remarque rejoint les objections de Guillaume Durieux. Jean-Louis Vullierme associe pagliacisme et idiocratie. Il ne me semble cependant pas certain que la notion d’idiocratie puisse servir de concept explicatif ou même descriptif. Qu’une politique soit ignorante ou aberrante, qu’un dirigeant élu soit incompétent ne suffisent pas à faire une « idiocratie » au sens où la légitimité du pouvoir y serait fournie par l’idiotie — ce sens étant le seul qui puisse justifier l’emploi de ce mot comme un véritable concept s’ajoutant à ceux de démocratie (légitimation du pouvoir par le peuple), technocratie (légitimation du pouvoir par la compétence technique), etc.
Il ne serait certes pas impossible de jouer sur l’étymologie du mot « idiot » en rappelant que ce terme désignait en grec la particularité (idios), le fait d’être à part ou à l’écart : l’idiocratie serait alors un pouvoir qui se légitime par l’entêtement dans la singularité incommunicable, le refus de l’universel en quelque sens que ce soit, la volonté d’être à part à tout prix, même à son propre détriment. De fait, certaines formes d’orgueil national sont « idiotes » au sens étymologique du mot aussi bien qu’au sens contemporain. Mais le sens contemporain ne se laisse pas effacer. Un idiocrate serait un dirigeant choisi par l’électorat en raison de sa stupidité ou de son incompétence ; un tel mobile de choix ne semble pas avoir cours. Ceux qui votent Trump votent pour lui parce qu’ils le jugent plus compétent que les autres pour protéger leur pays contre les effets négatifs du libre-échange ou contre la puissance de la Chine ; ils estiment que sa richesse est une preuve de sa compétence d’homme d’affaires et de négociateur qui s’y connaît en économie ; ils pensent qu’il va lutter contre l’influence (qu’ils jugent néfaste) du sécularisme, du féminisme et du radicalisme des campus ; ils peuvent avoir toutes sortes d’autres raisons, mais celles-ci ne sont pas liées à une préférence pour l’idiotie ou l’incompétence. Mais ces réserves envers la notion d’idiocratie n’empêchent pas, me semble-t-il, de constater l’effet paradoxal de légitimité que peut conférer une pratique de l’outrance, de la vulgarité et du grotesque. Jean-Louis Vullierme renvoie à un passage d’un cours de Michel Foucault qui soulignait que « la souveraineté grotesque » est « l’un des rouages qui font partie inhérente des mécanismes du pouvoir » (1). Il s’agissait pour Foucault de remarquer que le grotesque peut être un mode d’affirmation du pouvoir : le souverain prouve sa supériorité en s’autorisant le grotesque qui disqualifierait un citoyen ordinaire. Robert Damien a approfondi l’analyse en étudiant la façon dont le grotesque pouvait être, non seulement une manifestation du privilège dont le pouvoir dispose sur ceux qu’il domine, mais une façon paradoxale de se légitimer auprès de ses sujets par sa monstruosité même, qui serait le signe d’une « surnature » justifiant un pouvoir exceptionnel. C’est ainsi, note Robert Damien, que le « prince pornocrate » prouve sa puissance par l’exhibition de sa virilité : le grotesque est alors le signe d’une surpuissance qui, dans le cadre d’une « politique viriliste », est la preuve d’un droit à exercer le pouvoir. Le Prince glouton, débauché, bestial, est la figure assumée d’un « virilisme politique » pour lequel le pouvoir se légitime et pour ainsi dire se prouve lui-même par son outrance, sa violence, son indifférence à la norme, sa jubilation transgressive (2).
(1) Michel Foucault, Les Anormaux. Cours au Collège de France 1974-1975, « Leçon du 8 janvier 1975 », Paris, Ehess/Gallimard/Seuil, 1999.
(2) Robert Damien, « Le Prince pornocrate », Cités n° 16, 2003/4, p. 177-188. R. Damien a repris ces analyses dans son grand livre Éloge de l’autorité, Paris, Armand Colin, 2013, p. 103sq.
Il y a là quelque chose de plus qu’un simple signal d’une position « hors système ». Passons sur le fait qu’il est difficile de voir en un Berlusconi ou un Trump des individus qui auraient été « hors système » : ils ne sont pas François Ruffin. Mais indépendamment même de ce fait (important), il n’est pas absurde de voir dans le pagliacisme autre chose qu’une façon, pour un leader, de se positionner du côté du « peuple » (un « peuple » alors identifié à la vulgarité, à la haine, à la violence). Le pagliacisme signale d’abord un mépris de l’État de droit et de la démocratie délibérative. Le leader pagliaciste, par son comportement, affiche son mépris des procédures du droit, des médiations institutionnelles, et même de la simple politesse. Il manifeste ainsi, avant tout chose, son illibéralisme. Virilisme et vulgarité signalent un primat de la force sur la loi et invitent l’électeur à s’identifier à la violence pour en éprouver la jouissance sadique. Cette identification est le ressort d’une adhésion positive, et non d’un choix stratégique ou par défaut.
Les pièges du mot « populisme »
Cela m’amène au second point. Il me semble erroné de rapporter d’une quelconque manière le pagliacisme au populisme, sauf à donner à ce dernier terme une signification si vague qu’il devient inutilisable. Jean-Louis Vullierme ne les confond pas, mais il semble identifier le populisme à une préférence donnée aux « personnes les moins éduquées » et il donne le bolchévisme comme exemple de « positions populistes sans pagliacisme ».
Lénine et les populistes russes
Il me semble ici nécessaire de rappeler que Lénine a commencé sa carrière en polémiquant violemment contre les populistes russes, et qu’il a conçu sa propre politique comme une politique antipopuliste : il s’agissait précisément dans le bolchévisme de ne pas faire confiance au peuple (jugé incapable de s’élever par lui-même au-dessus du syndicalisme, jusqu’au point de vue révolutionnaire) et de confier en conséquence aux cadres du parti la mission d’éduquer le peuple et de le guider — en attendant, après la prise de pouvoir, de le terroriser.
On ne peut entrer ici dans une revue de la vaste littérature concernant le populisme ni dans une discussion des théories contemporaines qui s’opposent quant à sa définition. Il me semble cependant nécessaire, même en termes trop sommaires, de souligner les pièges dans lesquels nous font tomber les usages actuels du mot, ou du moins ses usages dominants dans le débat public. Avant les années 1980, le populisme désignait deux grands types de mouvements politiques.
D’une part, il renvoyait au populisme russe et au populisme américain, c’est-à-dire à des mouvements démocratiques qui se sont donné à eux-mêmes le nom de populistes. Ces mouvements visaient à défendre les libertés publiques en affermissant le pouvoir de la loi et du droit tout en les accompagnant de mesures égalitaires, telles que le développement des services publics financés par l’État ou la progressivité de l’impôt. Ce populisme a trouvé son expression cinématographique chez John Ford (4) et dans des films comme Mr. Smith goes to Washington et Meet John Doe de Frank Capra. En ce premier sens, le populisme est un mouvement de défense de la démocratie contre des captations oligarchiques du pouvoir économique et politique. Il ne suppose ni culte du leader ni hostilité au pluralisme ; il ne porte aucun projet socialiste (il ne vise pas à créer une nouvelle société), mais il défend la démocratie existante au nom d’un sens commun démocratique partagé par tous.
(3) Voir Antoine Chollet, « Un autre récit du pouvoir constituant. L’homme qui tua Liberty Valance et la question de la visibilité », Raisons politiques n° 71, 2018/3, p. 163-180.
Les régimes tels le péronisme
D’autre part, à la suite des travaux de Gino Germani, le nom de « populisme » ou de « national-populisme » s’est imposé pour qualifier des régimes latino-américains qui ne s’étaient jamais donné ce nom, tel le péronisme. Germani, qui avait fui en Argentine le fascisme italien et était hostile au péronisme, jugeait le concept de fascisme trop inadéquat pour ce qu’il observait sur place, malgré les tendances fascistes des dirigeants péronistes (tendances qui se sont trouvées contrecarrées par la base sociale et électorale du péronisme). Ce qui justifiait selon lui le terme de populisme, c’était le fait que ces régimes, tout en réprimant férocement les mouvements communistes, avaient mené des politiques de démocratisation sociale en accordant un certain pouvoir aux syndicats, dans le cadre d’une alliance entre l’armée et la plèbe tournée contre l’alliance des grands propriétaires fonciers et des classes moyennes supérieures. En ce deuxième sens, le populisme se présente, non comme une défense de la démocratie, mais comme une défense ou un service du peuple par un leader qui incarne la nation et la protège contre ses ennemis extérieurs et intérieurs. Le populisme prend ici une coloration autoritaire et antipluraliste : il oppose un « nous » unifié à un « eux » dans un climat nationaliste. Si on utilise cependant le nom de « populisme », c’est pour marquer que tout lien à la démocratie n’est pas rompu : ces régimes populistes ne sont dits tels que dans la mesure où on estime qu’ils ne basculent pas dans le fascisme mais promeuvent une certaine égalité sociale et, à cet égard, démocratisent des sociétés extrêmement inégalitaires. Ce sens du mot peut difficilement être arraché au contexte latino-américain où il s’inscrit ; on ne saurait l’appliquer aux sociétés européennes où les libertés publiques restent assurées, où les inégalités sont d’un autre ordre, où les prélèvements obligatoires sont élevés et où l’État social continue à assurer des fonctions redistributrices.
Un sens dévoyé
Depuis les années 1980, le terme de populisme a gagné un troisième sens, en particulier en Europe où il a été massivement utilisé par les éditorialistes pour qualifier des mouvements dont on jugeait les revendications déraisonnables ou irresponsables. C’est ainsi par exemple que, d’une manière qu’on est en droit de juger abusive (4), le Front national a de plus en plus souvent été qualifié de « populiste », alors même qu’il ne présentait aucun des caractères des populismes historiques et relevait d’un nationalisme xénophobe assez classique, qui n’avait jamais reçu auparavant le nom de « populisme ».
(4) Voir Annie Collovald, Le « Populisme du FN » : un dangereux contresens, Broissieux, éditions du Croquant, 2004.
Un premier piège
Un premier piège s’est construit ici. Pour dire les choses brutalement, le mot « populisme » en est venu à désigner toute revendication populaire jugée irrationnelle et contraire au savoir des experts — au point que « populisme » semble parfois n’être que le nom que les défenseurs d’une vision technocratique de la politique donnent à la démocratie elle-même, comme l’a remarqué Jan-Werner Müller. S’est créée ainsi l’idée dangereuse selon laquelle il faudrait opposer au populisme un élitisme (le pouvoir des experts), et récuser l’idée (essentielle à la démocratie) selon laquelle les questions politiques doivent être décidées par la délibération de tous. Cette idée antidémocratique a été défendue par des penseurs néolibéraux comme Friedrich Hayek, dont l’influence a été immense depuis la fin des années 1970.
Un deuxième piège
Un deuxième piège s’est construit (ou s’est emboîté dans le premier) lorsque l’extrême droite et les diverses formes de nationalisme xénophobe se sont engouffrées dans la brèche ainsi créée et ont décidé de revendiquer à leur profit le terme de « populisme » (comme le font aujourd’hui Viktor Orban, Nigel Farage, Éric Zemmour, Steve Bannon, Alain de Benoist, désormais rejoints par Michel Onfray). Il a dès lors été permis à l’extrême droite nationaliste de se présenter comme opposée à « l’élitisme » et de revendiquer une légitimité démocratique à laquelle elle n’avait en fait aucun droit, puisqu’aucune des mesures qu’elle propose ne peut passer, en un quelconque sens du terme, pour une mesure de démocratisation, d’extension ou de consolidation des droits. Déclaré « populiste », l’illibéralisme de l’extrême droite devenait soudainement « démocratique », alors que cet illibéralisme, défini par son hostilité aux libertés publiques et à l’État de droit, était par essence hostile à la démocratie.
Un troisième piège
Un troisième piège s’est alors édifié : pour réagir contre la captation du terme de « populisme » par l’extrême droite, un certain nombre d’intellectuels et de militants progressistes ont décidé de réactiver le sens progressiste du « populisme ». Est né ainsi le programme d’un « populisme de gauche » qui donnerait à l’opposition du peuple et des élites un sens « social », voire « intersectionnel » (celui d’une opposition des « dominés » de toutes sortes au groupe des « dominants »). Ce « populisme de gauche » a le mérite de rappeler le caractère démocratique du populisme historique ; hélas, il ne fait que valider l’opposition du peuple et des élites telle qu’elle a été construite par les penseurs technocratiques d’une part, par les instrumentalisations d’extrême droite du concept de populisme d’autre part. Ce « populisme de gauche » joue un intenable double jeu puisqu’il entend se définir comme « de gauche » tout en affirmant que l’opposition droite/gauche doit être abandonnée au profit d’une opposition entre peuple et élites (ce qui retrouve le « ni droite ni gauche » cher à l’extrême droite). Et, au lieu de s’atteler à une analyse dialectique de la diffraction des inégalités, des complexités de l’interdépendance économique et des transformations de l’État social, il se contente d’une pensée magique nommée « dégagisme », qui dénonce des « élites » indéterminées et leur oppose le bon sens des « petites gens », en semblant croire qu’il suffirait de chasser les « méchants » pour régler les questions sociales et écologiques.
Le populisme nord-américain
Le populisme nord-américain avait en un sens réussi dans et par son échec même : il s’était fondu dans le parti démocrate, qu’il avait ainsi démocratisé. Le populisme de gauche semble pris dans un dilemme : ou bien avouer que son « populisme » n’est que provisoire et doit se fondre dans une revitalisation sociale de l’idéal social-démocrate ; ou bien courir à la défaite face à un « populisme d’extrême droite » bien plus efficace que lui, car bien plus capable d’agréger les haines sans avoir besoin de les mettre en cohérence. Ce « populisme » droitier ne fera en effet que profiter des thèmes illibéraux diffusés par le « populisme de gauche », qui lui servira alors de force d’appoint idéologique dans sa lutte contre l’État de droit et dans la construction d’une opposition entre un peuple « de souche », aux volontés et aux traditions « authentiques », et un « faux peuple » composé par l’alliance des « élites mondialisées », des « intellectuels déracinés », des « assistés » et des « étrangers ». Berlusconi opposait ainsi « l’Italie qui travaille » à « l’Italie qui bavarde ».
Le paradoxe du « populisme de gauche » est que, en définissant le populisme par l’opposition du peuple aux élites, il oblige à tenir le populisme droitier pour un authentique populisme. Il n’y a pourtant là qu’un faux-semblant : quoi qu’il en soit de la pertinence ou de la valeur de l’idée de populisme (qui ne convient peut-être qu’à des états désormais dépassés de la société démocratique), pourquoi donner ce nom à un nationalisme qui propose des politiques de chauvinisme social adossées à des croyances magiques, quand il ne propose pas carrément des politiques férocement oligarchiques, mélangeant racisme et darwinisme social ? Pourquoi valider l’idée que le peuple désigne l’inculture et l’ignorance par opposition aux savoirs experts ? Le populisme nord-américain reposait de fait sur l’idée de la primauté du sens commun démocratique. Mais ce sens commun n’était ni une récusation de la science, ni l’invocation d’un « esprit national » opposé à la rationalité ; il était surtout l’appel à un sens du commun, c’est-à-dire à l’inclusion de tous dans la délibération démocratique. Ce sens du commun est défiguré une première fois lorsqu’il est retraduit dans l’idée d’une politique de l’hostilité entre un « eux » et un « nous » incarnée par un leader ; il devient définitivement méconnaissable lorsqu’il prend la forme d’une opposition complotiste entre un peuple qui n’aurait pas besoin de savoir pour vouloir et des savoirs scientifiques qu’on serait en droit de récuser arbitrairement, parce que « tel est le bon plaisir du peuple ».
Un nationalisme à tendance césarienne
Quelles que soient ses déficiences et ses limites, et si grave que soit le risque qui lui est immanent — qui est de convertir une frustration démocratique en un ressentiment proto-fasciste —, le populisme désigne originellement une demande de protection du peuple par la loi. La loi, disait Hegel, est le « shibboleth » qui permet de démasquer les « faux amis de ce qu’ils appellent le peuple » : ceux qui invoquent le peuple pour piétiner l’esprit des lois et la séparation des pouvoirs peuvent difficilement être tenus pour des amis du peuple. Ce qu’on appelle aujourd’hui « populisme » n’est le plus souvent qu’un nationalisme avec des tendances césariennes, visant à remplacer la démocratie par le plébiscite. Donner à ce césarisme nationaliste le nom de « populisme » est lui faire un cadeau indû : on confond les Gracques et les tribuns de la plèbe avec Catilina et César — ou, pour donner des exemples de césarisme pagliaciste, avec Néron et Caligula. Pire encore : on confond la demande d’une égalité de tous au sein de la collectivité politique avec un phénomène tout différent, que Patrick Savidan a nommé « la démocratisation du sentiment oligarchique » et qu’il a décrit, dans un article de 2016 où il analyse les ressorts du vote en faveur de Trump, comme l’expression « d’une aspiration de plus en plus étendue, partagée, à être du bon côté du manche, du côté de ceux qui ont le pouvoir de dominer, de maîtriser, de ceux qui ont, le plus, le mieux, les moyens de protéger leur mode de vie, en externalisant au maximum la vulnérabilité, la pauvreté, l’exclusion ». N’oublions pas que l’électorat qui soutient Trump n’est pas constitué des classes populaires ou de la plèbe, mais bien des petites classes moyennes qui craignent la précarisation. N’oublions pas que le professeur Raoult, en qui on voit parfois un « populiste sanitaire », aime à dire qu’il est « l’élite » : cette posture, qui est celle d’une autorité n’acceptant de se soumettre ni aux règles normales de l’évaluation scientifique, ni à l’éthique de la discussion, n’est pas celle d’un populiste mais bien d’un expert « césarien ».
L’aspirant dictateur singe le peuple
Il me semble que le pagliacisme est précisément une expression de la « démocratisation du sentiment oligarchique » que diagnostique Patrick Savidan : l’aspirant dictateur singe le peuple (ce qui veut dire qu’il produit du peuple une image simiesque), il substitue le vulgaire au populaire, il piétine la loi pour faire que les masses s’identifient à la posture tyrannique et trouvent dans les transgressions de leur chef une participation aux plaisirs de la tyrannie. En ce sens, le pagliacisme s’oppose au populisme auquel il ne ressemble qu’en le simulant et en le pervertissant, sur le mode d’une inversion caricaturale. Le milliardaire héritier qui incite à mépriser l’État de droit n’incarne pas « l’homme du peuple », même s’il attaque « l’establishment » : il incarne un idéal de réussite brutale, qui ne craint pas de piétiner les faibles. Son pagliacisme donne à cette brutalité le statut d’une violence jouissive, qui s’exhibe dans le sarcasme et s’offre aux identifications complices. Les simagrées ubuesques permettent de court-circuiter le débat rationnel : celui qui raille et conspue n’a plus besoin d’argumenter ; il s’efforce de disqualifier par le grotesque la pratique même de l’argumentation, comme si elle était risible. Ubu se présente comme supérieur à la « tête d’œuf », parce qu’il est drôle et n’a pas peur de la vulgarité. Ce phénomène ne doit pas être confondu avec le populisme, et il doit encore moins être pensé dans les termes d’un concept élitiste du populisme, qui confond ce dernier avec l’idiocratie. C’est pourquoi, à mon avis, le concept de pagliacisme est précieux.
Jean-Louis Vullierme : L’intelligence du pagliacisme
Réponse à Guillaume Durieux
L’objection la plus fondamentale opposée par Guillaume Durieux au concept de pagliacisme est qu’il implique un jugement sur les compétences de certains électeurs, qui paraît se heurter d’une manière élitiste au principe de neutralité des sciences sociales. Le fait néanmoins que les habitants d’une société ne disposent pas d’un même niveau d’instruction est une réalité dure parmi les autres. On doit aussi prendre en considération l’existence de désordres cognitifs susceptibles de s’emparer de tout ou partie d’une population, tels que la propagation de rumeurs infondées, la désignation de boucs émissaires, et d’autres encore, qui se manifestent en liaison non exclusive mais néanmoins synergique avec le faible niveau d’instruction.

Le niveau d’instruction ne détermine pas l’orientation idéologique
Dans les sociétés modernes, l’instruction est censée comporter un minimum d’apprentissage de la discrimination entre les faits soumis à vérification protocolaire et les affirmations faisant seulement l’objet d’un renforcement par répétition, entre les raisonnements valides et les paralogismes, entre les apparences et les illusions, et entre les sources de qualités différentes. L’information recueillie principalement par les émissions de télévision à visée ludique, les spectacles de polémique, la presse politique interprétant les évènements dans le seul sens de l’idéologie du lecteur, et validée dans le contexte des groupes de renforcement cognitif de réseaux sociaux manipulables, ne dispose assurément pas de la qualité d’une information acquise auprès de sources plus diverses, et contrôlée de manière plus méthodique. Il importe de souligner que le niveau d’instruction ne détermine pas l’orientation idéologique, puisque les idéologies sont généralement formulées in fine par des personnes disposant d’un très haut niveau d’instruction, qui s’affrontent l’une l’autre. J’ai moi-même établi dans un travail antérieur qu’une partie fondamentale de la doctrine d’Adolf Hitler reposait sur une connaissance directe des « sciences raciales » telles qu’elles étaient enseignées à son époque dans les principales universités du monde (1). Il n’existe en aucune façon une « pensée unique » chez les élites intellectuelles, comme on peut le constater tous les jours en observant la virulence de leurs affrontements. Cependant, il existe des manières très diverses de se fier ou non aux propagandes et aux affirmations, qui ne sont pas indépendantes du niveau d’éducation.
(1) Jean-Louis Vullierme Le Nazisme dans la Civilisation : Miroir d l’Occident, Paris, L’artilleur, 2018.
Si l’on accepte de considérer l’instruction comme l’un des marqueurs de la compétence, la corrélation entre le vote pagliaciste et un plus faible niveau d’instruction est empiriquement vérifiée, avec certaines nuances, dans les exemples les plus manifestes. Pour les élections présidentielles américaines de 2016, dans le groupe majoritaire autodéfini comme « blanc », un plus bas niveau d’études était un prédicteur du vote Trump plus significatif que le revenu, qui est, lui, un indicateur fort des intérêts économiques de l’électeur. Il n’est donc pas possible dans un tel cas de considérer le niveau d’instruction comme un simple effet secondaire du niveau économique, malgré la présence d’une corrélation partielle entre les deux. De façon analogue, les électeurs disposant du niveau d’instruction le plus faible aux élections italiennes de 2018 étaient davantage favorables à la Ligue, parti dont le matamore ajoute un raffinement de vulgarité à des politiques publiques les unes autoritaires et les autres sans prise sur les réalités internationales.
Les intérêts économiques de l’électeur
Une seconde objection est que l’appréciation d’une contradiction entre les intérêts des électeurs et leur vote, par un observateur extérieur, serait nécessairement arbitraire. Il se trouve pourtant qu’elle est en partie mesurable, non seulement, comme ci-dessus, en utilisant comme indicateur ex ante la position économique et sociale de l’électeur, mais plus encore ex post en observant une corrélation inverse avec la politique conduite. C’est ainsi que D. Trump a massivement favorisé les avantages fiscaux des plus fortunés (qui n’étaient pas ses électeurs principaux), comme celui des entreprises mondialisées dont il se prétendait l’adversaire, sans opérer de transferts nouveaux en faveur des classes moyennes dont il s’affirmait le représentant. Ou encore, sa politique de fermeture des frontières a mécaniquement pour effet d’accroître lentement les coûts des consommations intermédiaires transformées par les producteurs américains, le prix des biens de consommation achetés par la classe moyenne, de réduire par rétorsion les exportations américaines, le tout sans augmentation significative possible de l’emploi dans un pays qui était en plein-emploi au moment de son arrivée aux affaires, et même avec une réduction de l’activité dépendante des types d’emplois à faible valeur ajoutée comme à très faible rémunération généralement acceptés par les seuls immigrants de fraîche date.
La foi du pagliaciste
Une troisième objection est que d’être victime des promesses mirobolantes d’un matamore serait le signe d’une bêtise intrinsèque que l’on n’a cependant pas le droit d’imputer d’autorité à un groupe entier de population. Aussi bien n’est-ce pas de bêtise qu’il s‘agit. Un projet mirobolant se définit comme trop beau pour avoir des chances de se réaliser : par des moyens faibles, on obtiendrait un effet énorme. Or, comme dans le cas du prestidigitateur, il n’est pas toujours facile, même en étant soi-même tout à fait intelligent, d’identifier l’erreur ou la supercherie. De la même manière que seule une personne un tant soit peu versée en thermodynamique peut comprendre qu’il est inutile de présenter un projet reposant sur le mouvement perpétuel, seule une personne possédant des notions élémentaires d’économie financière peut comprendre d’emblée qu’il n’est pas possible, sans banqueroute, de rembourser en monnaie faible créée à cet effet une dette libellée en monnaie forte. Cette analyse, dans une situation plus normale, est conduite par la presse, les syndicats, les cercles de réflexion et les partis eux-mêmes. Et c’est pourtant ce que plus d’un pagliaciste s’est (au moins initialement) promis de faire, pour se libérer, comme par magie, de contraintes qui déplairaient à ses électeurs, en discréditant pour ce faire globalement la totalité des sources non fantaisistes d’information : universités, presse traditionnelle, cercles d’experts, etc. Le matamore n’est en général pas une personne informée et cynique qui diffuserait des idées qu’il saurait fausses, d’où sa préférence pour l’incompétence, et le recrutement de collaborateurs sans expérience des domaines qui leurs sont confiés, mais présentant seulement une affinité idéologique avec lui (quelle que soit cette dernière). De la même manière que le pagliaciste peut imaginer lui-même sincèrement que l’emploi est une denrée fongible, telle que la fermeture des frontières permettrait ipso facto de créer des emplois que l’électeur serait désireux d’accepter ; il peut aussi ignorer que le statut rare et enviable de détenteur d’une monnaie de réserve mondiale a pour condition la préservation d’un déficit commercial, en réalité financé par les pays excédentaires. Il doit donc, pour combattre ce déficit qui lui est pourtant favorable, s’entourer de collaborateurs aussi incompétents que lui. C’est ainsi qu’il finit par constituer un gouvernement formé de personnes qui gèrent l’environnement dans l’ignorance des conclusions scientifiques sur le réchauffement climatique, de la même façon qu’il s’appuie, en politique étrangère, sur des ministres qui peuvent croire qu’une négociation diplomatique majeure peut réussir sans offrir de contreparties sérieuses.
Des alternatives aux partis traditionnels
La quatrième objection est que le pagliacisme ne peut avoir d’existence que s’il a une raison d’être, du fait que les partis politiques traditionnels n’incluent pas dans leurs programmes des éléments non pagliacistes de nature à recueillir l’assentiment d’une partie notable de l’électorat. Or, ceci n’est pas une objection à la notion de pagliacisme, mais au contraire un des motifs de son émergence. C’est bien parce que les partis traditionnels se heurtent à des difficultés qu’ils ne parviennent pas à surmonter – par exemple la croissance de la dette publique en présence d’un besoin croissant de transferts sociaux – que certains électeurs recherchent des alternatives.
Le cas de Cinque Stelle est à cet égard intéressant puisque l’électorat du parti y est davantage animé par des considérations institutionnelles, dans un contexte de blocage structurel des institutions. En dépit du fait que le mouvement ait été initié par un clown professionnel et repris par un successeur ayant pour formation celle d’un agent de sécurité, il a fait moins de promesses intrinsèquement irréalisables que son rival de la Ligue, s’orientant (sans grand succès cependant) vers une démocratisation des institutions. Il a de ce fait recueilli un vote significativement plus éduqué, surtout depuis que son propre matamore s’est effacé. Cet effacement n’a pas fait disparaître l’incompétence de ses dirigeants, mais a incontestablement normalisé le mouvement qui joue toujours un rôle antisystème, mais désormais en tant que parti de gouvernement non essentiellement pagliaciste (une coloration qu’il pourrait ou non reprendre dans le futur). L’antiélitisme pagliaciste, qui implique un rejet des compétences, ne se confond donc pas avec l’antiélitisme ordinaire, qui implique un rejet des situations acquises. Le pagliacisme peut ou non s’emparer du statut de parti antisystème central, permettant à des électeurs eux-mêmes bien informés de pratiquer une politique du pire pour des raisons tactiques ; il peut ou non être idiocratique, puisque son matamore peut ou non être manipulé en tout ou partie par des puissances parfaitement intelligentes agissant par cynisme en vue de leur propre agenda (Steve Bannon, Roger Stone ou gouvernements étrangers) ; il peut ou non être populiste (dans un sens ou dans l’autre de la notion). Mais il a bien une existence sui generis, qui se caractérise par l’émergence d’une personnalité initialement forte d’une simple notoriété médiatique acquise dans un contexte ludique, multipliant les promesses mirobolantes, discréditant pour ce faire tous les systèmes existants de validation intellectuelle, faisant fi de la logique et des faits, s’extrayant par l’affirmation grotesque des limites imposées par la décence, et s’entourant de collaborateurs suffisamment incompétents pour entériner ses politiques, qu‘il prive, autant qu’il le peut, du pouvoir de les rectifier.
Le pagliacisme est propre à notre époque
Le pagliacisme (à la différence du seul grotesque assumé) est propre à notre époque. Son apparition est liée à la montée en puissance des réseaux sociaux, à la dévaluation du crédit accordé à l’instruction et à la critique dialogique. Il constitue une réponse contemporaine à la crise des partis traditionnels en démocratie parlementaire (crise qui est un phénomène récurrent, ayant reçu d’autres réponses dans le passé). La figure du matamore l’incline vers les solutions autoritaires de la démocrature, tandis que son inefficience intrinsèque ne peut qu’aggraver les crises qui l’ont porté. Le pagliacisme se multiplie dans le monde à une vitesse accélérée, ayant pris le pouvoir dans diverses démocraties parlementaires, comme le Brésil, et même, d’une façon atténuée, en Grande-Bretagne. Il présente des candidats dans une variété de pays européens encore indemnes. C’est pourquoi il convient de le prendre au sérieux et de le traiter comme un grave danger politique, sans lui accorder le genre d’indulgence qu’une attitude comique peut ordinairement inspirer.


2 Responses
[…] des traits populistes. Mais elle se distingue du populisme par ses traits ubuesques et « néroniens » — « pagliacistes », comme les nomme Jean-Louis Vullierme. Alors que le populisme se revendiquait de la […]
[…] DURIEUX, Guillaume, PRANCHÈRE, Jean-Yves et VULLIERME, Jean-Louis, Pagliacisme et populisme, INRER, 29 juin 2020. https://inrer.org/2020/06/pagliacisme-populisme-discussion/ […]