Par Jean-Louis Vullierme
Le philosophe livre une réflexion sur l’internationale nationaliste dont Poutine est devenu la figure de proue et Trump, l’ange messager. Un plaidoyer contre le souverainisme.
Pourquoi les nationalistes européens sont-ils presque tous devenus poutinistes, et pourquoi Poutine s’emploie-t-il à leur accorder hébergement médiatique et financements?
Il fut une époque où l‘ennemi d’un nationaliste était le nationaliste d’un autre pays. Pour s’entre-détruire, ils s’inventaient chacun un nationalisme au carré, volontairement différent selon toute apparence du nationalisme étranger, comme le fit Renan contre l’Allemagne avec succès. Désormais, une internationale nationaliste s’est constituée dont Poutine est devenu le pape, s’épargnant d’entretenir des divisions blindées que son économie sans valeur ajoutée ne lui permet plus d’équiper à grands frais. Les nationalistes ont fini par s’aimer les uns les autres, découvrant tous en Trump, ange messager de Poutine, une victime à la défense des libertés de laquelle ils s’empressent de voler. Certaines des gauches extrêmes en viennent à partager un sentiment de communauté devant l’injuste censure imposée à l’incendiaire par des forces trop mondialisées.
Pour comprendre cette évolution, c’est à Napoléon III qu’il convient de remonter, et au «principe des nationalités». Le nationalisme n’est pas seulement un moyen de mobiliser une population en l’expurgeant de ses éléments exogènes, il est aussi une arme pour disloquer un empire rival. Le paradoxe est que cette arme ne peut être exploitée que par un empire. Bonaparte avait compris que l’urgence n’était plus aux frontières immédiates mais aux réserves coloniales de l’adversaire: d’où Arcole et Aboukir. Mais c’est son neveu qui s’employa à miner la Sainte-Alliance, en détachant l’Italie de la tutelle autrichienne. L’instrumentation des nationalités ne s’embarrassait pas alors de précautions excessives, puisque l’empereur français s’attribuait au passage la Savoie et Nice, où était né Garibaldi, un aventurier qui s’était ingénié à diviser l’Amérique latine en parties réduites, contrairement au rêve intégrateur de Bolivar. Napoléon III se faisait le protecteur d’un pays sous curatelle, qui ne partageait pas encore en pratique une langue commune, et dans lequel il assurait le maintien des États pontificaux, cœur d’une religion où résidait toujours l’essentiel de l’homogénéité ethnique de la Péninsule, mais que la France des Lumières entendait à présent remplacer.
Depuis lors, le principe des nationalités n’a cessé de nourrir son parfum libérateur. Quoi de plus positif, en effet, que «le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes»? C’est fort de cette conviction que Woodrow Wilson arriva à Paris le 14 décembre 1918. Le leader d’un continent établi sur l’écrasement des nations amérindiennes venait en Europe présider au traité de Versailles. Au terme des opérations, en vertu du principe d’autodétermination, Versailles et ses annexes démantelèrent l’Autriche-Hongrie (Yougoslavie, comprenant Serbie, Monténégro, Croatie et Slovénie, plus la Bosnie-Herzégovine; Tchécoslovaquie y inclus les Sudètes), et l’Empire ottoman (Syrie, Palestine, Liban, Irak, Arabie). Ainsi naquirent des situations inextricables qui servirent de prétextes à l’expansion nazie à l’Est, et demeurent parmi les foyers de conflits les plus purulents au XXIe siècle. Les États-Unis pouvaient se retirer, forts d’avoir introduit la liberté, la paix, mis la guerre hors la loi, et permis aux nations, libres par essence, de régler pacifiquement leurs conflits par la SDN à laquelle ils dédaignent d’adhérer, sous la lointaine tutelle d’une économie devenue la première au monde, et qui ne s’embarrasserait plus de leurs querelles. Wilson avait, à sa manière, remplacé Napoléon III.
Le nationalisme, toutefois, est animé d’une attitude inquiète: avons-nous assez unifié notre population, nous assurant qu’elle partage exactement les mêmes mœurs, et n’avons-nous pas laissé nos frères irrédents enfermés pour leur malheur dans d’autres frontières? Il n’y eut pas d’autres justifications affichées aux manœuvres diplomatiques qui conduisirent à Munich. «Seulement un peu plus», disait-on, «encore un dernier complément, un détail, afin de retrouver enfin nos cousins opprimés par des États multinationaux et criminels du même fait».
Alors qu’en 1914, près d’une dizaine d’empires se partageaient la planète, quand la seconde guerre s’acheva, il n’en restait que deux sur la Terre. Leur préoccupation commune fut de vassaliser tous les anciens empires qui n’étaient pas eux-mêmes, en les réduisant à leurs territoires métropolitains. Il ne leur importait nullement que les nouvelles «nations» nées des Indépendances n’aient aucune unité tribale ni autonomie économique sur des territoires suffisamment larges, qu’elles soient pour la plupart des conglomérats de langues, d’ethnies historiquement rivales, et de régions dépourvues de complémentarité. On se garderait bien de les orienter vers la formation de grandes fédérations disposant d’une taille compatible avec le développement. Mieux valait les asservir par des ventes à crédit d’armements qui les conduisaient plutôt à se diviser davantage.
La fin de la guerre froide ne fit pas disparaître les empires. Malgré l’implosion politique de l’URSS, la Russie resta la plus vaste étendue territoriale du monde, sous une main de fer résolue à ne plus en céder une parcelle, quitte à gouverner par répressions implacables les républiques rétives comme la Tchétchénie. Le dernier grand empire géographique sur Terre entendait passer discrètement pour la simple «nation russe», alors que les immensités à l’est de l’Oural avaient été arrachées, à peu près aux mêmes dates, dans des conditions analogues aux colonies européennes d’Afrique. Qui parle aujourd’hui de décoloniser le territoire russe, comme on n’hésiterait pas à le faire s’il s’agissait d’un autre continent? La victoire idéologique est si totale, qu’il s’agit, à l’inverse, d’inviter les nationalistes étrangers que l’on protège à admettre de bon cœur la récupération de l’Ukraine. Moscou qui ne veut pas à ses frontières d’une Europe unifiée, et capable à ce titre de déterminer le destin de son gaz, et qui veut moins encore d’une Europe bénéficiant d’un parapluie américain qui la contraindrait à des efforts militaires qu’elle ne peut plus soutenir, se borne, avec intelligence, à subventionner des mouvements nationalistes étrangers et à les rendre dépendants d’elle. Le Kremlin le fait à l’heure où ses désordres internes et sa répudiation du droit rendent impensable d’investir dans son économie, et de la développer. De cela, la Chine sans doute se chargera, avec la lenteur et la détermination qui la caractérisent.
Or si nous avons ainsi la réponse au «pourquoi Poutine» et «pourquoi l’internationale nationaliste», nous ne voyons toujours pas clairement la réciprocité indéfectible entre nationalisme et empire tutélaire, ni qu’elle peut connaître une toute autre solution. L’autodétermination fictive des nations peut être remplacée par l’autodétermination du citoyen, qui exerce sa magistrature depuis la municipalité à laquelle il participe, jusqu’à sa région, son pays et sa fédération, sans être plafonné par des fragmentations servant, en réalité, des intérêts hostiles. Sans masse critique, les unités politiques sont toujours privées d’exercer leur autonomie. Elles peuvent seulement se soumettre ou se grouper à l’inverse dans des circonscriptions électorales à l’échelle des continents. Ce sont les empires qui emploient les nationalistes pour les convaincre du bien fondé du chauvinisme et de la supériorité morale de l’isolement. L’Europe ne peut se construire par des nations, mais par des citoyens qui en élisent toutes les instances qui se complètent alors l’une l’autre avec cohésion sous un contrôle électoral. Si s’enclenche ce processus qui exige une contribution puissante des forces unionistes, à quelque partie du spectre politique qu’elles appartiennent, il fera voir rétrospectivement que, derrière la figure des nations, il n’y avait eu en réalité qu’un simulacre de citoyenneté.

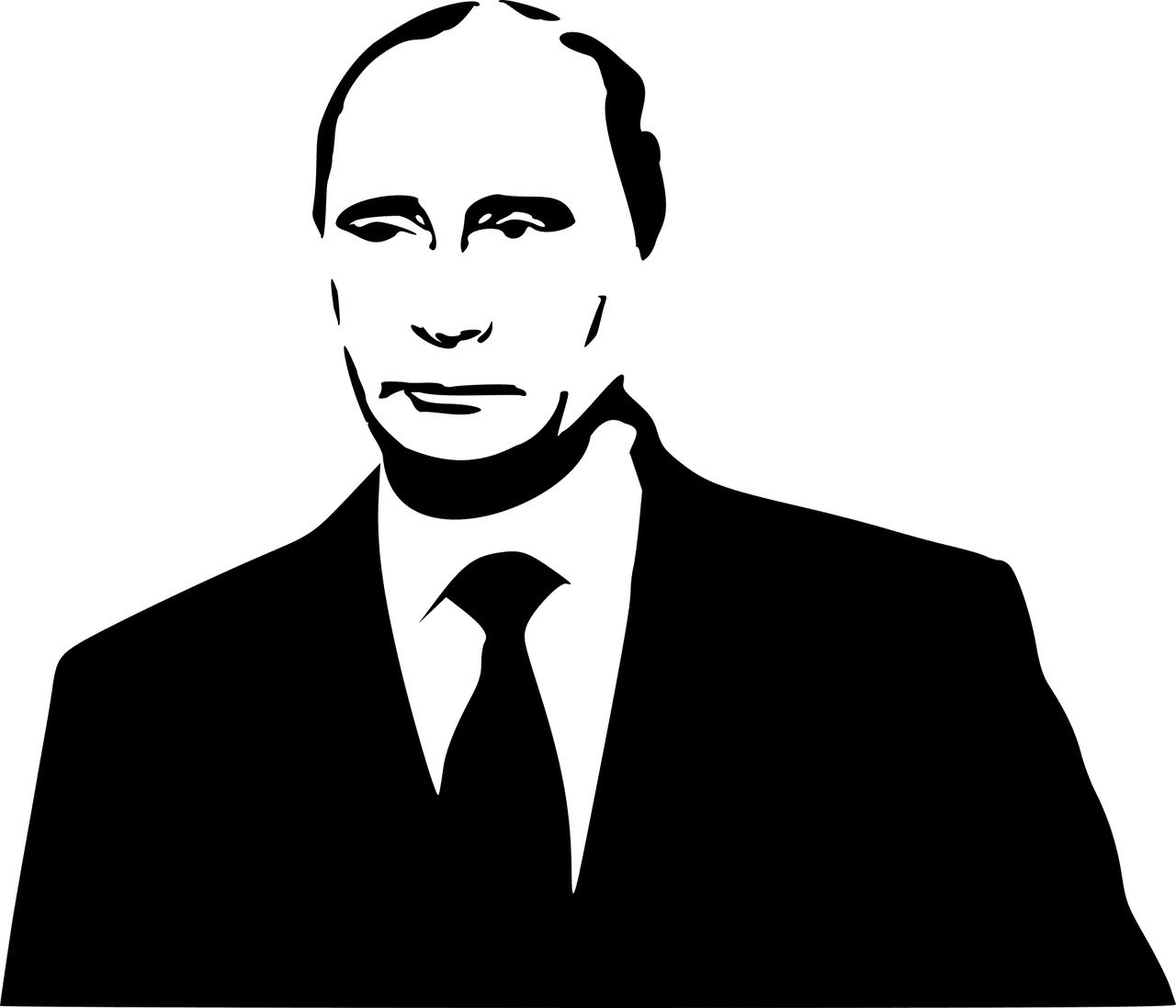
No responses yet