Par Alain Policar
Nulle véritable surprise dans le chemin qu’emprunte, désormais sans vergogne, Michel Onfray (« faux philosophe et histrion de la pensée contemporaine », écrit Alain Jugnon, auteur d’un salutaire essai : Contre Onfray) : il est celui, profondément inquiétant, de l’alliance rouge-brun, laquelle, à vrai dire, ne réunit que les bruns déclarés avec d’autres bruns camouflés. Les signes d’internationalisme prolétarien proviennent du seul Onfray, mais on a de bonnes raisons de douter de son engagement, ses déclarations d’amour étant réservés aux ouvriers blancs.
La création de cette revue, Front populaire, avec des collaborateurs qui vont du Rassemblement national au Printemps républicain1, avec la sympathie affichée de la Nouvelle Droite (par la bouche de son leader historique, Alain de Benoist), est l’indice, s’il en fallait encore, de l’offensive national-souverainiste dont les structures intellectuelles se nourrissent de l’identitarisme, c’est-à-dire de la sauvegarde de « nos » valeurs contre celles qui viendraient d’ailleurs. Ce clivage entre « eux » et « nous » s’exprime dans la préférence pour Proudhon contre Marx, tel que M. Onfray la résume : le premier est « issu d’une lignée de laboureurs francs » alors que le second est « issu d’une lignée de rabbins ashkénazes ».
On pourrait s’étonner que ces effluves d’antisémitisme ne gênent pas les militants du Printemps républicain dont la marque de fabrique est sa dénonciation. On aurait tort car, selon eux, il existe un antisémitisme qu’il convient de combattre, celui des quartiers, principalement arabo-musulman, et un autre acceptable, celui de l’extrême droite, car il serait fondé sur l’exaltation des valeurs nationales et ne prêterait, dès lors, guère à conséquence (c’est sans doute une part de l’explication du soutien persistant d’Alain Finkielkraut à Renaud Camus).

Défendre « notre » identité nationale est ainsi devenu le lien consistant entre des courants par ailleurs relativement hétérogènes. C’est désormais le nom du racisme de notre temps. Un temps marqué par la prééminence de l’hostilité sur l’hospitalité. Un temps de nostalgie pour nos racines où nous sommes « invités » à avouer ce qui compte vraiment : « Lorsqu’on me demande ce que je suis au fond de moi-même, cela suppose qu’il y a “au fin fond” de chacun une seule appartenance qui compte, sa “vérité profonde” en quelque sorte, son ”essence” déterminée une fois pour toutes à la naissance et qui ne changera plus ; comme si le reste – sa trajectoire d’homme libre, ses convictions acquises, ses préférences, sa sensibilité propre, ses affinités, sa vie en somme – ne comptait pour rien » (Amin Maalouf, Les identités meurtrières, p. 10-11).
Pourquoi le besoin d’appartenance conduit-il trop souvent à la peur de l’autre et à sa négation ? Pourquoi la revendication d’une identité collective tend-elle à se confondre avec la promotion de celle-ci ou, plus exactement, d’un élément de celle-ci au détriment de tous les autres ? Ce dernier choix (ce terme n’est sans doute pas le plus adapté pour désigner la soumission à des origines largement fantasmées) ne résiste pourtant pas à l’examen. Comment, en effet, ne pas être frappé par la variabilité temporelle de la hiérarchie des éléments identitaires ?
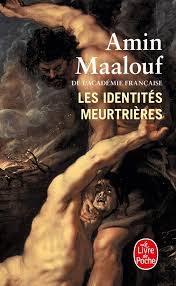
L’identité sur laquelle se fondent les principes de l’exclusion est, comme l’a qualifiée Ali Benmakhlouf, une « fable philosophique ». Ce sont très largement les conventions linguistiques qui nous incitent à voir une permanence derrière toute identité. Il suffit de songer à l’hétérogénéité culturelle des nations modernes pour comprendre l’impossibilité de réduire leur identité à un substrat objectif et immuable. On ajoutera que la capacité à s’arracher au donné et à choisir d’autres appartenances que celles qui nous ont été transmises est une spécificité humaine extrêmement précieuse. Et, plus fondamentalement, l’horizon de l’homme n’est évidemment pas d’être assigné à ses origines ou enfermé dans son passé. Ce qui reste essentiel est l’identification par l’intermédiaire des mythes et des symboles.
Dans la voie tracée par Paul Ricœur, on doit par conséquent insister sur le caractère essentiellement narratif de l’identité nationale. L’un des effets de cette narrativité est justement l’impossibilité de définir le noyau dur de l’identité réelle d’une nation dans l’objectif illusoire de savoir à quoi les immigrants doivent s’intégrer. On met ainsi l’accent sur l’importance du choix des mythes dans l’ouverture à la diversité. Ainsi ceux qui perpétuent l’illusion de l’unité culturelle ou morale de la nation alimentent une conception non inclusive de celle-ci.
En outre, identifier l’origine géographique d’un homme, c’est vraiment dire peu de choses sur lui. Contrairement à ce que croit le raciste qui perçoit des identités et non des êtres singuliers, et qui considère avoir tout dit sur un homme lorsqu’il sait d’où il vient, il reste tout à connaître de cet être, différent de tous les autres, y compris de ceux auxquels il ressemble. C’est cette réalité anthropologique que nie la barbarie identitaire.
Il nous semble que cette négation définit correctement l’entreprise nauséabonde de M. Onfray et de ses affidés. Tous ceux qui se veulent par l’imagination descendants de rabbins ashkénazes lui opposeront l’espérance cosmopolitique, c’est-à-dire le point de vue d’un humanisme civilisationnel qui regarde l’espèce comme un ensemble de relations. Être citoyen du monde, écrivait le regretté Tzvetan Todorov, dont la pensée s’est nourrie des principes universels que célèbre la devise républicaine et non des racines des laboureurs francs, « c’est faire partie du devenir de celui qui vient après moi, c’est traiter les générations qui n’existent pas encore comme des concitoyens envers lesquels existe un devoir d’un type particulier qui est “un devoir du genre humain envers lui-même” » (dans son Essai d’anthropologie générale, heureusement intitulé La vie commune). De cette vie commune participent tous ceux qu’Achille Mbembe nomme, avec bonheur, les « passants ».
Ce texte d’Alain Policar, membre d’honneur de l’INRER, est d’abord paru dans Libération.
- Notre ami Alain Policar n’a pas jugé utile de préciser ses allégations au sujet du Printemps Républicain, dans sa tribune dont le thème n’est pas celui-ci, mais le Front populaire de Michel Onfray.
À proprement parler, aucun membre actuel du mouvement militant Printemps Républicain ne participe au projet du Front populaire de Michel Onfray. Mais dans l’équipe, plusieurs personnalités sont ou ont été proches du Printemps Républicain, qu’il s’agisse de campagnes menées conjointement, de campagnes similaires, de partages réciproques d’articles et posts Facebook, de commentaires publics amicaux et/ou élogieux, ou encore de tribunes cosignées ou de conférences communes. L’INRER tient tous documents à disposition.
Techniquement, Céline Pina, très proche jusque très récemment des leaders du mouvement, avait d’abord adhéré à l’idée avant de s’en retirer. Barbara Lefèbvre avait longuement et ardemment attaqué, sur les réseaux sociaux, en compagnie de membres du Printemps Républicain, la tribune que nous avions publiée dans Le Monde sur l’antisémitisme en mai 2018. Henri Pena-Ruiz a été défendu par les leaders du Printemps Républicain, et il a lui-même publiquement soutenu l’un de ces leaders, qui l’ont invité à une de leurs Journées en décembre 2019. Mathieu Bock-Côté a souvent été louangé par les leaders du Printemps Républicain sur les réseaux sociaux.
Sur le fait que le Printemps Républicain trouverait “acceptable” l’antisémitisme d’extrême droite, l’INRER tient à préciser que ce mot n’a jamais été prononcé par les leaders du mouvement. Très actifs sur les réseaux sociaux, les membres du groupement militant ne l’ont en revanche jamais été concernant l’antisémitisme d’extrême droite, mais particulièrement concernant l’antisémitisme islamiste.


One response
Merci pour ce beau texte qui m’incite en outre à découvrir les ouvrages mentionnés de Todorov et Maalouf